
« Le vieux libraire m’avait toujours répété que les livres avaient une âme, l’âme de celui qui les avait écrits et de ceux qui les avaient lus et avaient rêvé avec eux » (Carlos Ruiz Zafón, Le jeu de l’ange).
La bibliothèque d'Étienne Chomé
Jeux du "je" jusqu'au coeur du coeur

« Le vieux libraire m’avait toujours répété que les livres avaient une âme, l’âme de celui qui les avait écrits et de ceux qui les avaient lus et avaient rêvé avec eux » (Carlos Ruiz Zafón, Le jeu de l’ange).
« La femme est dans le feu, dans le fort, dans le faible. La femme est dans le fond des flots, dans la fuite des feuilles, dans la feinte solaire où comme un voyageur sans guide et sans cheval, j’égare ma fatigue en une féerie sans fin » (Louis Aragon).


« Il est des rencontres magiques… Il est des rencontres magiques qui surgissent dans notre vie sans prévenir…
Il est des rencontres qui ont un caractère magique par la qualité de ce qu’elles révèlent, en nous, ou chez l’autre…
Il est des rencontres qui nous appellent au plus profond de notre être, du plus lointain de notre histoire…
Il est des rencontres qui éclaireront notre parcours de vie d’une lumière plus vive, plus féconde…
Je souhaite à chacun de pouvoir accueillir l’une de ces rencontres, si elle fait irruption dans sa vie, et de s’y abandonner de tout son cœur » (Jacques Salomé).
« L’ombre du frêne,
venin n’entraîne »
(proverbe français).

« Les arbres sont de grands sages. Bien ancrés dans le sol, ils sont à l’écoute de la terre, mais cela ne les empêche pas d’avoir la tête dans les nuages et d’écouter les histoires du vent, et encore de vouloir aller plus haut, vers la lumière » (Michel Tournier).
Terre-mère/mer, air, lumière (du Père
‘qui est aux Cieux’), vive le
carré sémiotique et phonétique
qui anime chaque vivant…
« Tu n’as pas besoin de tout faire.
Fais ce que te dicte ton cœur.
L’action efficace vient de l’amour.
Elle est inarrêtable, et elle est suffisante »
(Joanna Macy).

« Il est si facile de briser et de détruire.
Les héros sont ceux qui font la paix et qui construisent »
(Nelson Mandela, Pensées plurielles).
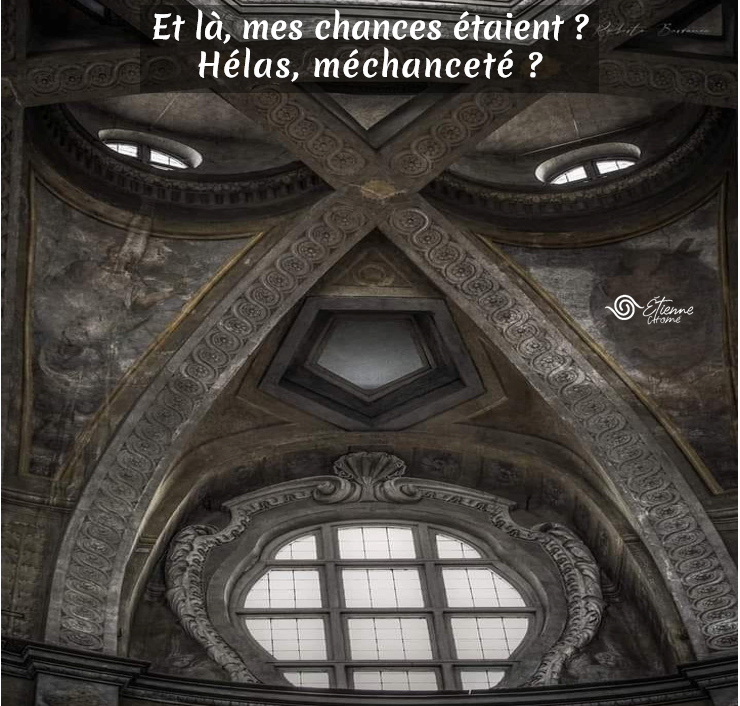
Ce dimanche matin, en rentrant de l’île Maurice vers la Belgique, je suis tout à la joie d’avoir vécu l’aube la plus longue de ma vie passée et présente : dans l’avion, j’ai admiré les toutes premières lueurs de l’aube, à partir de 4 h.45, au-dessus de Zagreb puis Vienne. Ensuite, à peine les splendeurs colorées de l’aurore apparaissaient, nous avons entamé notre descente. Ce plan de vol tenait le parfait timing pour nous faire une marche arrière : en effet, en baissant d’altitude et en se tournant plus résolument vers l’ouest, nous sommes retournés au début de l’aube. En changeant d’espace, nous sommes remontés dans le temps = dans la chronologie habituelle de ce début de journée de fin d’été : une aube encore montante au-dessus de Munich et Francfort et puis descendante pour contempler Aix-la-Chapelle et la Belgique. Nous avons atterri sur le plancher des vaches à Bruxelles dans la nuit totale, pour accueillir à nouveau l’aube déroulant son tapis de couleurs ! Magnifique début de journée, aux quatre mille secondes d’aubes reloaded ; L’aube-Laudes, où j’ai chanté des psaumes en ayant intérieurement enfilé mon aube liturgique blanche (le blanc rassemblant toutes les couleurs de l’arc-en-ciel dans la lumière de la Vie)… Vive ce beau ‘jour du Seigneur’


Remake un an plus tard, en août 2023 : cette fois, après une longue aube, j’ai eu la joie de voir le soleil jouer au saute-moutons. Il est sorti de l’horizon puis rentré, puis sorti, puis rentré, à répétition… Amazing…

Dans ses lettres, Ignace de Loyola exprime
que tout est donné par surcroît à qui
reçoit comme bénédiction la rosée du ciel,
réalise que Son amour vaut mieux que tout,
choisit la confiance au cœur de ses inquiétudes,
cherche d’abord le Royaume de Dieu et sa justice.


Noble et tendre amitié, je te chante en mes vers.
Du poids de tant de maux semés dans l’univers,
par tes soins consolants, c’est toi qui nous soulages,
trésor de tous les lieux, bonheur de tous les âges
(Jean-François Ducis, Épître à l’amitié, 1786).

« Être capable de communier avec les autres êtres par une activité nue et dépouillée qui, en nous arrachant à nous-même, nous donne accès à la totalité du réel, dont l’existence individuelle nous avait d’abord séparés.
Tout homme qui prétend garder quelque chose pour lui seul se forge à lui-même sa propre solitude.
Connaître l’extrémité de la pauvreté, en s’ouvrant sur la totalité du monde avec un cœur pur et des mains libres, pour connaître l’extrémité de la richesse qui nous permet à chaque instant, en abolissant en nous toute arrière-pensée, d’entrer réellement en société avec tous les êtres que Dieu met sur notre chemin » (Louis Lavelle, Tous les êtres séparés et unis, 1940, début de la deuxième guerre mondiale il y a 82 ans).