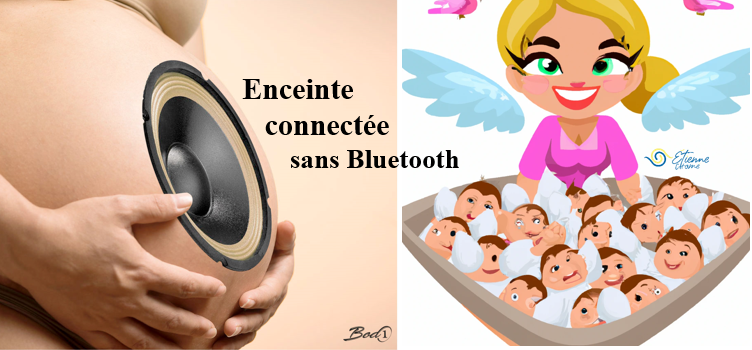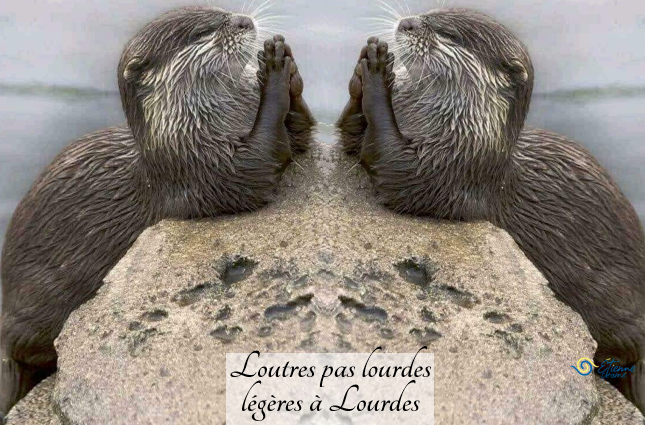Ceci est la suite de mon post autour du livre Les Croisades vues par les Arabes d’Amin Maalouf. Derrière les arguments religieux, fournissant l’habillage idéologique justifiant la guerre qu’on veut mener, c’est l’histoire tristement répétée des mâles humains qui se lancent dans une guerre quand ils estiment que le rapport des forces en géopolitique penche à leur avantage. Les Occidentaux à l’offensive au cours de ces neuf ‘croisades’ les XIe, XIIe et XIIIe siècles, eurent à subir de lourdes contre-offensives les trois siècles suivants, jusqu’à la bataille de Lépante, signant la défaite pour longtemps des Arabes ; jusqu’à leur réveil, devenu possible grâce au pétrole. Ainsi en va le monde qui passe : un jeu de conquêtes et de contre-conquêtes, selon la loi du plus fort…
Ces invasions franques au début du Millénaire passé ont exactement les mêmes ressorts de pouvoir de domination que le choc de nos civilisations d’aujourd’hui (cf. les parallèles de Maalouf dans sa conclusion), avec, entre les deux, les colonisations et néocolonisations…
De quoi donner le tournis à qui joue à « Qui assaille qui ? »…